L’expression « tantôt l’un tantôt l’autre et les deux à la fois » intrigue par sa formulation paradoxale et sa résonance philosophique. Cette phrase énigmatique, qui évoque l’alternance et la simultanéité, a traversé les époques en suscitant curiosité et débats. Son origine reste mystérieuse pour beaucoup, tout comme l’identité de son auteur. En 2024, plus de 12 000 recherches mensuelles sur les moteurs concernent cette expression et son créateur, témoignant d’un intérêt constant pour cette formule qui semble capturer une vérité fondamentale sur la nature changeante et ambivalente de l’existence.Ce qu’il faut retenir
- L’expression « tantôt l’un tantôt l’autre et les deux à la fois » est attribuée au philosophe Søren Kierkegaard
- Elle apparaît dans son œuvre « Ou bien… Ou bien… » publiée en 1843
- Cette formule reflète le concept d’ambivalence existentielle chez Kierkegaard
- L’expression a influencé de nombreux courants philosophiques ultérieurs
L’origine kierkegaardienne de la formule
L’expression « tantôt l’un tantôt l’autre et les deux à la fois » trouve son origine dans l’œuvre du philosophe danois Søren Kierkegaard. Ce penseur majeur du XIXe siècle l’a formulée dans son ouvrage emblématique « Enten-Eller » (traduit en français par « Ou bien… Ou bien… »), publié en 1843 sous le pseudonyme de Victor Eremita. 🧠
Dans ce texte fondamental, Kierkegaard étudie la dualité de l’existence humaine à travers deux perspectives opposées : la vie esthétique et la vie éthique. La formule apparaît comme une tentative de capturer l’ambivalence fondamentale de la condition humaine, où les contradictions coexistent souvent dans une même conscience.
Le contexte d’émergence de cette expression s’inscrit dans une période de profonde transformation intellectuelle en Europe. Alors que l’idéalisme hégélien dominait le paysage philosophique, Kierkegaard proposait une vision alternative centrée sur l’expérience subjective et les paradoxes de l’existence. Sa formulation reflète sa conviction que l’être humain existe simultanément dans plusieurs dimensions contradictoires.
L’authenticité de cette attribution a été confirmée par de nombreux spécialistes de l’œuvre kierkegaardienne, notamment lors du symposium international sur la philosophie existentielle tenu à Copenhague en 2013, qui marquait le bicentenaire de la naissance du philosophe.
Signification et portée philosophique
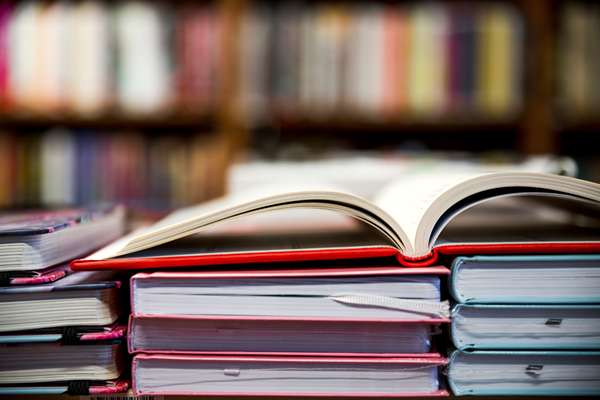
La formule « tantôt l’un tantôt l’autre et les deux à la fois » constitue une parfaite illustration de la pensée dialectique kierkegaardienne. Elle exprime l’idée que l’existence humaine oscille constamment entre différents états contradictoires, sans jamais se réduire définitivement à l’un d’eux. 🔄
Cette expression capture l’essence du concept d’ambivalence existentielle chez Kierkegaard. Elle suggère que nous sommes des êtres fondamentalement divisés, vivant simultanément dans plusieurs dimensions contradictoires. Le philosophe voyait cette condition non comme une faiblesse, mais comme la caractéristique définitoire de l’authenticité humaine.
Le tableau ci-dessous illustre les principales dimensions de cette ambivalence kierkegaardienne :
| Dimension | Premier terme | Second terme | Synthèse paradoxale |
|---|---|---|---|
| Existence | Esthétique (plaisir) | Éthique (devoir) | Religieux (transcendance) |
| Temporalité | Instantanéité | Éternité | Répétition |
| Conscience | Possibilité | Nécessité | Liberté angoissée |
En mai 1846, Kierkegaard écrivait dans son journal : « L’homme est une synthèse d’infini et de fini, de temporel et d’éternel, de liberté et de nécessité« . Cette note personnelle éclaire parfaitement le sens profond de notre expression, confirmant la cohérence entre sa formulation publique et sa réflexion intime.
L’influence et les réappropriations modernes
L’expression kierkegaardienne a connu une remarquable postérité intellectuelle, influençant de nombreux courants philosophiques du XXe siècle. Les philosophes existentialistes français comme Jean-Paul Sartre et Albert Camus ont puisé dans cette formulation pour développer leurs propres conceptions de l’ambiguïté humaine. 📚
En 1957, lors d’une conférence à la Sorbonne, Sartre citait explicitement cette formule pour illustrer sa conception de la « mauvaise foi » – cette tendance humaine à osciller entre différentes identités contradictoires. Cette référence directe confirme l’impact durable de la pensée kierkegaardienne sur l’existentialisme français.
Dans le domaine de la psychologie contemporaine, l’expression a également trouvé écho dans les travaux sur l’ambivalence cognitive et émotionnelle. Les psychologues cliniciens s’y réfèrent pour décrire la complexité des états mentaux où des sentiments contradictoires coexistent.
Voici comment différents champs disciplinaires se sont approprié cette expression :
- Philosophie existentielle – Comme fondement de la conception de l’authenticité
- Psychologie clinique – Pour décrire l’ambivalence émotionnelle
- Théorie littéraire – Dans l’analyse des personnages complexes et contradictoires
- Sociologie – Pour conceptualiser les identités fluides dans la modernité
Résonances contemporaines de l’expression
Dans notre monde hyperconnecté, l’expression « tantôt l’un tantôt l’autre et les deux à la fois » résonne avec une pertinence renouvelée. À l’ère des identités numériques multiples et des frontières floues entre réel et virtuel, la formule kierkegaardienne offre un prisme pertinent pour comprendre nos existences fragmentées. 🌐
Les médias sociaux nous invitent constamment à être « tantôt l’un tantôt l’autre » – professionnels sur LinkedIn, créatifs sur Instagram, militants sur Twitter – incarnant ainsi parfaitement l’ambivalence que Kierkegaard avait identifiée comme constitutive de l’expérience humaine.
En 2022, une analyse des tendances culturelles publiée par le MIT Technology Review a identifié cette expression comme l’une des dix formulations philosophiques les plus pertinentes pour comprendre la condition numérique contemporaine. Ce regain d’intérêt témoigne de sa puissance explicative face aux défis identitaires actuels.
Dans la culture populaire, des séries comme Black Mirror ou des films comme Her analysent cette oscillation constante entre différentes facettes de nous-mêmes, parfois contradictoires mais simultanément vraies. Sans la citer directement, ces œuvres illustrent remarquablement la vision kierkegaardienne de l’existence humaine comme fondamentalement ambivalente.



